Les forces et limites de l’approche matricielle
Parmi les différentes stratégies à la disposition des équipes de validation, l’approche matricielle occupe une place à part. Elle intrigue, rassure, divise parfois. Certains y voient un levier d’efficacité redoutable, d’autres un risque méthodologique sous-estimé.
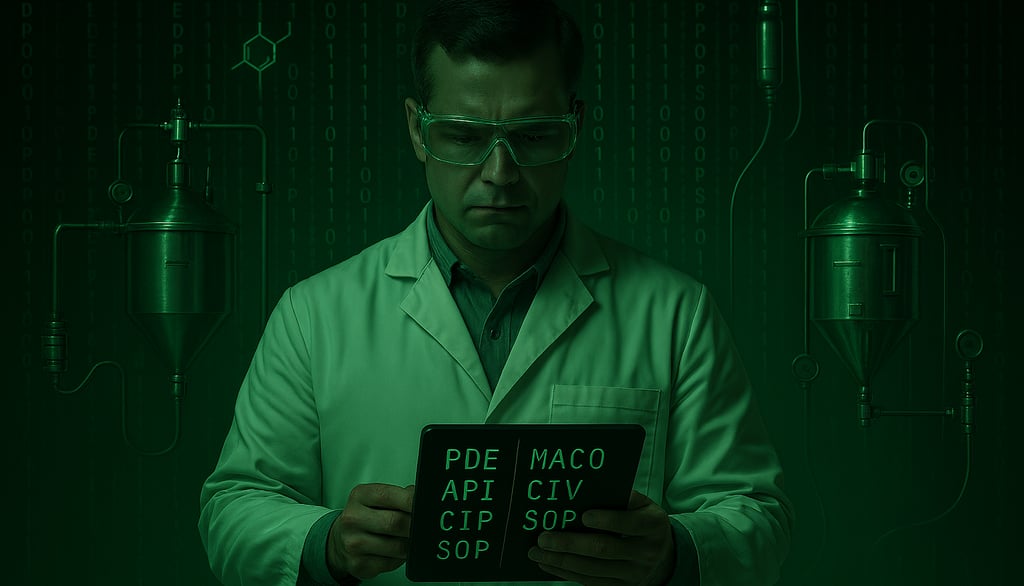
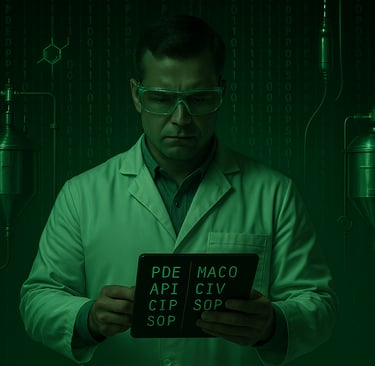
La validation des procédés de nettoyage est souvent perçue comme un exercice technique, exigeant, parfois même laborieux....et c'est loin d'être faux.
Parmi les différentes stratégies à la disposition des équipes de validation, l’approche matricielle occupe une place à part. Elle intrigue, rassure, divise parfois. Certains y voient un levier d’efficacité redoutable, d’autres un risque méthodologique sous-estimé.
Mais qu’est-ce qui fait réellement la force – et la fragilité – de cette approche ?
Comprendre l’approche matricielle
L’approche matricielle repose sur une idée simple : plutôt que de valider individuellement le nettoyage de chaque produit sur chaque équipement, on regroupe des entités similaires afin de les regrouper.
Les produits sont organisés selon leurs propriétés (exemple: toxicité, solubilité, difficulté de nettoyage), les équipements selon leur complexité ou leur capacité à retenir des résidus, et éventuellement les procédés de nettoyage selon leur caractéristiques (bien que, généralement, la condition sine qua non d’un groupage équipement-produit soit l’utilisation d’un même procédé de nettoyage).
Une fois ces regroupements établis, on identifie un worst-case, c’est-à-dire l’élément le plus critique du groupe, celui dont la maîtrise garantit celle des autres.
Cette méthode ne se contente pas de simplifier : elle structure. Elle ne réduit pas seulement le nombre de validations, elle donne un sens à leur sélection.
Les avantages d’une stratégie intelligente
Ce qui séduit d’abord dans l’approche matricielle, c’est son élégance. Elle transforme une problématique volumineuse en un système organisé, lisible, cohérent. Dans les environnements multi-produits, où les validations pourraient s’enchaîner à l’infini, elle permet de concentrer les efforts sur ce qui compte vraiment : les produits les plus difficiles à nettoyer, les équipements les plus critiques, les paramètres procédés les plus défavorables.
On gagne du temps, bien sûr, mais aussi en pertinence. L’approche matricielle s’inscrit dans une logique de gestion des risques : elle oblige à comprendre ce qui rend un produit véritablement critique, à analyser les procédés, à comparer objectivement les caractéristiques toxicologiques, physico-chimiques ou opérationnelles. Elle renforce la réflexion scientifique au lieu de la diluer.
Un autre avantage, souvent sous-estimé, réside dans la capacité de la matrice à accueillir de nouveaux produits. Lorsque sa structure est bien définie, l’arrivée de nouveaux éléments (produit, équipement, ...) ne provoque plus un tremblement de terre documentaire : il suffit d’évaluer sa place dans la matrice et finalement de vérifier s’il redéfinit un nouveau worst-case, à valider ou non. Cette stabilité apporte une sérénité précieuse dans des environnements où les portefeuilles évoluent sans cesse.
Les limites, parfois discrètes mais bien réelles
Si l’approche matricielle facilite la vie, elle peut aussi la compliquer lorsqu’elle est mal conçue. Sa première faiblesse vient de l’excès de confiance qu’elle peut inspirer. Une approche matricielle mal documentée, ou construite sur des critères discutables, donne une illusion de sécurité sans en offrir la réalité. Le cas le plus fréquent : un worst-case mal choisi, trop théorique, qui ne reflète pas la réalité du terrain, où qui engendre des conditions à valider qui ne sont alors plus du tout réprésentative de la réalité du terrain.
C'est notamment le sujet de l'article "Le piège du worst-case".
L’autre difficulté apparaît dès sa mise en place. Construire une matrice robuste demande un volume important de données et une excellente connaissance de ces produits et équipements, et procédé de fabrication. C’est un travail multidisciplinaire, exigeant, qui mobilise aussi bien la production, le contrôle qualité, la validation, parfois même jusqu'au développement pharmaceutique. La phase initiale est très énergivore, et nécessite des argumentaires solides pour résister à une inspection.
Enfin, l’approche matricielle n’est pas universelle. Elle s’adapte très bien aux environnements où les produits se ressemblent, où les équipements sont réutilisés de manière homogène. Mais dans les produits hautement toxiques ou même lorsque la diversité des produits est très large, ses limites apparaissent rapidement.
À cela s’ajoute un dernier risque : la matrice figée. Les PDE changent, de nouveaux équipements apparaissent, des procédés évoluent. Une matrice qui n’est pas revue régulièrement devient rapidement obsolète — et donc difficilement défendable.
Une approche utile, à condition d’être maîtrisée dans le temps.
L’approche matricielle n’est ni une solution magique, ni un piège. C’est un outil. Une approche puissante lorsqu’elle est utilisée intelligemment, documentée avec rigueur, mise à jour régulièrement et soutenue par des analyses de risque solides. Elle peut transformer une validation nettoyage en une démarche efficace, rationnelle et défendable. Mais elle exige, en échange, une vigilance continue et une compréhension fine de son contexte.
Dans un monde où les exigences réglementaires s’intensifient et où les portefeuilles produits deviennent de plus en plus complexes, cette approche représente un équilibre subtil entre pragmatisme et rigueur scientifique. Un équilibre qu’il appartient à chaque entreprise de construire, d’entretenir… et d’adapter.
Comment redéfinir la manière de gérer cette approche ?
C’est précisément dans cette frontière entre complexité et rigueur que la solution Hally trouve son utilité.
La construction d’une matrice exhaustive, la sélection des bons critères, l’identification des worst-cases, la justification toxicologique, la mise à jour continue… toutes ces étapes prennent du temps, demandent de la cohérence et reposent sur des données parfois éparpillées.
Il ne faut pas oublier qu’il est tout à fait normal d’adapter ses choix stratégiques au fil du temps, notamment en raison de l’évolution réglementaire. En 2015, l’introduction de la notion de PDE, via le calcul du MACO HBEL, a rendu obsolètes la plupart des stratégies existantes.
Et en 2026 est prévu une nouvelle mise à jour de l'annexe 15 des BPF (The 3-year work plan for the Inspectors Working Group) et dans un objectif de fournir à la Commission européenne une version finale de l’Annexe 15 amendée, intégrant les nouvelles technologies pour les installations, produits et procédés, en tenant compte des recommandations du LLE, en élargissant le champ d’application aux API et en reflétant les évolutions issues de la révision de l’ICH Q9 R1 sur la gestion des risques qualité.
Il est très probable que cette mise à jour introduise de nouveaux éléments méthodologiques liés à la définition des critères de validation des procédés de nettoyage dans le périmètre des API, ainsi qu’un renforcement des approches basées sur le risque. L’intégration des notions de risque de contamination croisée, de contamination par les agents de nettoyage, de contamination microbiologique, voire de l’utilisation du risque recommendé dans les groupages produits, les équipements ou les plans d’échantillonnage, aura nécessairement un impact sur la définition des stratégies. Elle pourrait même renforcer le lien avec les approches QbD (un procédé de nettoyage reste avant tout un procédé) et, pourquoi pas, ouvrir la voie à l’introduction de concepts liés à l’intelligence artificielle.
Hally apporte une approche structurée à cette complexité. En centralisant les données produits, en automatisant les calculs, et en proposant une vision dynamique des regroupements, il permet de concevoir des matrices robustes, défendables et surtout vivantes ! Hally ne remplace pas l’expertise, mais il la rend plus fluide, plus fiable, plus fiable — et surtout plus pratique.
En somme, il transforme une approche méthodologique exigeante en un processus maîtrisé, évolutif, et parfaitement aligné avec les attentes des autorités.
