Une autre approche pour le scoring de la toxicité dans la définition des produits « worst case »
La toxicité est un critère clé pour définir le produit « worst case ». La méthode idéale repose sur les valeurs HBEL (PDE/ADE), mais elles sont souvent indisponibles. Une alternative simple et efficace consiste à utiliser les Occupational Exposure Bands (OEB), qui classent les substances selon leur toxicité en bandes standardisées, basées sur des limites d’exposition. Cette approche est rapide, cohérente et facilement exploitable, surtout quand les données toxicologiques détaillées manquent.
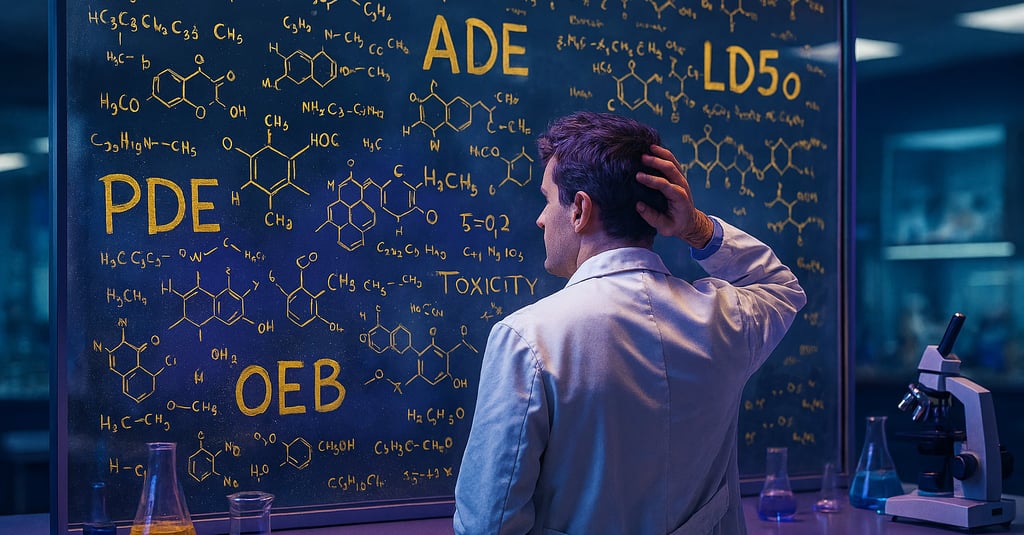
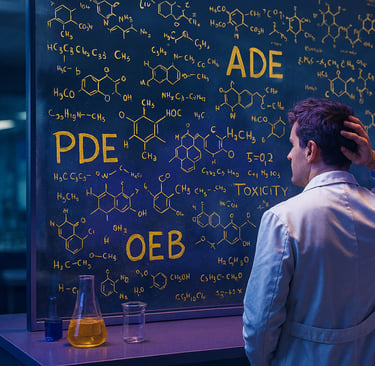
Dans la validation des procédés de nettoyage, notamment dans l’approche matricielle, la définition des produits worst-case est une étape essentielle.
Elle vise à identifier le produit (produit fini, intermédiaire de production, tampon, milieu, ...) le plus difficile à éliminer des équipements, celui qui représentera le scénario le plus contraignant à nettoyer, et donc l’élément principal à valider.
L’Annexe 15 des BPF a introduit une notion d'identification sur la base d'un scoring multicritère pour établir ce choix. Bien qu’il ne s’agisse que de recommandation, les quatre critères majeurs à prendre en compte sont bien connus : la solubilité, la nettoyabilité, l’activité et la toxicité.
Si les trois premiers peuvent souvent être évalués à partir de caractéristiques physicochimiques ou d’essais expérimentaux, la toxicité reste un critère délicat, en raison de la diversité des sources et des données disponibles.
Les approches classiques pour le scoring de la toxicité
1. Les valeurs HBEL : le Graal toxicologique
Quand on parle de toxicité, la méthode “idéale” reste bien sûr celle basée sur les HBEL (Health-Based Exposure Limits), avec des valeurs de référence comme le PDE (Permitted Daily Exposure) ou l’ADE (Acceptable Daily Exposure).
Ces données sont extrêmement fiables, car elles reposent sur des analyses toxicologiques approfondies, évaluant à la fois les effets aigus et chroniques, et intégrant des marges de sécurité adaptées. Scientifiquement parlant, c’est du solide.
Le problème, c’est qu’il faut les avoir.
Et dans la pratique, dès qu’on sort du cadre des principes actifs pharmaceutiques (API), ces valeurs sont souvent indisponibles ou incomplètes.
Entendons-nous bien : elles pourraient être calculées, mais obtenir l’ensemble des HBEL pour toutes les molécules et intermédiaires impliqués dans un procédé représente un travail titanesque… et surtout, un coût non négligeable.
Chaque valeur HBEL doit en effet être établie au cas par cas par un toxicologue qualifié, sur la base d’un examen des données toxicologiques existantes, parfois issues de la littérature scientifique, parfois nécessitant des extrapolations.
Autrement dit, c’est la méthode la plus rigoureuse… mais aussi la plus lourde à mettre en œuvre à grande échelle.
2. La DL50 (LD50)
Une approche plus simple et rapide consiste à se tourner vers la DL50, qui indique la dose nécessaire pour provoquer la mort de 50 % des animaux testés.
Cette donnée est largement disponible dans la littérature et peut servir de première estimation de la toxicité aiguë d’une substance.
Sur le papier, ça paraît facile. Mais dans la réalité — et pour tous ceux qui ont déjà tenté de s’y retrouver — les DL50 sont parfois difficilement comparables : oral, cutanée, inhalation, rat, lapin, souris… Autant de variables qui compliquent l’interprétation et rendent l’exercice moins évident qu’il n’y paraît.
En pratique, la DL50 peut donner un ordre de grandeur, mais elle reste trop approximative pour une évaluation de risque cohérente.
Et si on parlait OEB ?
C’est là qu’entre en scène une approche souvent sous-estimée mais redoutablement pratique : les Occupational Exposure Bands (OEB).
Le classement en bande d'exposition professionnelle est un processus destiné à classer rapidement et précisément les produits chimiques dans des catégories spécifiques (des bandes), qui correspondent à une échelle de concentrations d'exposition destinées à protéger la santé des travailleurs (McKernan et al. (NIOSH, 2016).
En deux mots, le principe est simple : chaque substance est classée dans une bande d’exposition (OEB 1 à OEB 5), qui correspond à une plage de concentration maximale admissible dans l’air (OEL). Plus l’OEB est élevée, plus le produit est toxique… et plus il mérite notre attention dans le choix du worst case. Et ces données sont généralement accessible dans les fiches de sécurité (FDS).
En clair : c’est un outil pensé pour aller vite, bien et de façon cohérente. Tout ce qu’on aime dans un modèle de scoring.
Exemple de scoring de la toxicité
OEB 1–2 :
• Intervalle OEL : > 100 µg/m³
• Interprétation : Toxicité faible à modérée
• Score : 1OEB 3 :
• Intervalle OEL : 10 – 100 µg/m³
• Interprétation : Toxicité moyenne
• Score : 2OEB 4 :
• Intervalle OEL : 1 – 10 µg/m³
• Interprétation : Toxicité élevée
• Score : 3OEB 5 :
• Intervalle OEL : < 1 µg/m³
• Interprétation : Toxicité très élevée
• Score : 4
Pourquoi cette approche fonctionne bien ?
Adopter l’OEB dans un modèle de scoring de produit worst-case, c’est un peu comme avoir un raccourci fiable :
Les données sont déjà disponibles (HSE, fournisseurs, fiches de données de sécurité…).
Le système est cohérent et standardisé : pas besoin de recalculer des PDE pour chaque molécule (notamment celles où l’on présent déjà qu’elles seront moins élevée que l’API).
Et surtout, il parle à tout le monde : les HSE connaissent déjà ces bandes, les responsables qualité les comprennent, et les équipes de validation peuvent les intégrer sans se casser la tête.
Pas besoin de réinventer la roue, elle existe déjà… et elle tourne bien.
Mais jusque-là, on parle de molécules individuelles, alors que dans la vraie vie, il est rare de travailler avec une seule substance pure.
Entre les milieux de culture, les tampons de formulation, les excipients, on se retrouve vite avec des compositions contenant parfois des dizaines de composants. Et c’est là que les choses se corsent.
Attribuer un OEB à une molécule isolée, c’est facile : une valeur, une bande, un risque.
Mais pour un mélange ? Bonne question.
En théorie, on pourrait calculer un OEB global du mélange, mais en pratique, les données toxicologiques nécessaires sont quasi inexistantes, notamment pour les milieux de culture.
Du coup, la solution la plus simple (et celle qu'on appliqué déja avec les données HBEL ou DL50) consiste à retenir l’OEB le plus sévère parmi toutes les substances présentes — autrement dit, celui de la molécule la plus toxique du mélange.
C’est une approche plutôt conservatrice… parfois un peu trop. Concrètement, si un seul composant du mélange est classé OEB 5, c’est tout le mélange qui hérite du même classement, même si le reste est aussi inoffensif que de l’eau.
Conclusion
En fonction du contexte, le scoring de la toxicité peut être un pilier essentiel de la définition des produits worst-cases. S’il est idéal de s’appuyer sur des valeurs HBEL (PDE ou ADE) lorsque celles-ci existent, l’utilisation des Occupational Exposure Bands (OEB) constitue une alternative robuste, pragmatique et directement exploitable.
